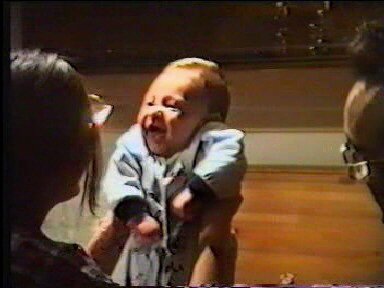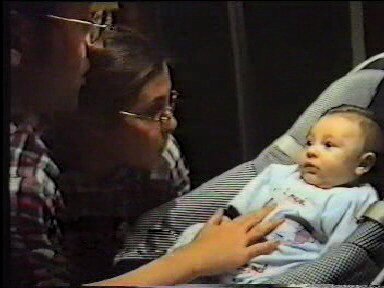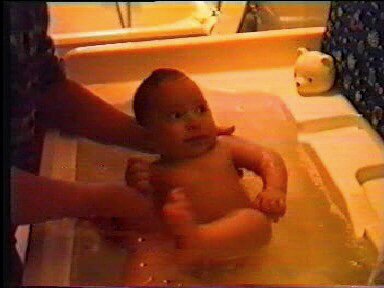La recherche PREAUT
Evaluation d’un ensemble cohérent d’outils de repérage des troubles précoces de la communication pouvant présager un trouble grave du développement de type autistique.
PHRC : Pr C.Bursztejn.
PréAut : G.C. Crespin, M.C. Laznik, Dr J.P.Muyard, Dr J.L.Sarradet, M.H. Wittkowski.
Introduction
Le syndrome autistique (SA) se caractérise par une altération qualitative et quantitative des interactions sociales, de la communication, et un caractère restreint, répétitif et stéréotypé des comportements, des intérêts et des activités.
Sa prévalence est estimée entre 8 à 16 cas pour 10 000 avec une prédominance masculine selon les critères retenus par différents pays. (France, Angleterre, Canada). Des estimations récentes font état de prévalences plus élevées atteignant 30 cas pour 10 000 dans certaines études.
Le diagnostic est établi le plus souvent vers l’âge de 3 ans selon des critères admis au niveau international - CIM 10, DSM-IV, mais il arrive encore que le SA ne soit diagnostiqué que vers 4 ans, lors des bilans systématiques pratiqués à l’école maternelle.
L’intérêt d’un diagnostic et d’une prise en charge aussi précoce que possible pour minimiser les handicaps dûs à l’autisme, fait actuellement l’objet d’un très large consensus. Des études ont montré une évolution bénéfique des enfants présentant un SA lorsqu’une prise en charge précoce a eu lieu.
Les signes caractéristiques du syndrome autistique sont rarement complets avant l’âge de 3 ans. L’ensemble de données recueillies, et notamment l’analyse systématique des données rapportées par les parents indiquent que dans 75 à 88 % des cas des signes existent avant 2 ans et dans 31 à 55 % avant 1 an.
Les recherches menées sur l’évolution d’enfants pour lesquels on dispose de films familiaux (Maestro et coll., 1999), suggèrent l’existence de plusieurs modalités de début de l’autisme.
Etant donné le caractère incomplet et même souvent discret de la symptomatologie très précoce de l’autisme, il serait utile qu’on dispose d’indicateurs validés, simples à utiliser dans le cadre des examens de santé habituels pour favoriser une meilleure et plus rapide orientation des familles vers des soins adéquats.
Historique de la démarche
En 1998, un groupe de psychiatres, psychologues et psychanalystes, tous praticiens de l’autisme, ont fondé l’Association PREAUT afin de réaliser une recherche visant la validation de signes de troubles de la communication pouvant présager un trouble grave du développement de type autistique.
La recherche PREAUT est promue par l’Association PREAUT (Paris, France), représentée par son Président, Dr. Jean-Louis Sarradet, et par le Programme Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC) du CHRU de Strasbourg, représenté par le Pr Claude Bursztejn.
La recherche PREAUT s’adresse aux pédiatres et médecins de la petite enfance qui reçoivent les bébés dès la naissance pour les visites systématiques du protocole de santé publique français, dans le cadre de la PMI (Protection Maternelle et Infantile). Depuis 1999, l’équipe PREAUT a formé environ 600 médecins dans 12 départements de France métropolitaine et d’outre mer à l’identification des signes de risque qui font l’objet de la recherche.
Sans privilégier aucune étiologie, l’hypothèse PREAUT postule qu’il doit y avoir, au cours des premiers mois de la vie, des situations psycho-relationnelles qui antecèdent la cognition et la rendent possible. Ces situations devraient pouvoir être observées dans la relation entre le bébé et son autre familier (habituellement, ses parents), bien avant que les marqueurs cognitifs habituellement recherchés –le pointage proto-déclaratif et le jeu de faire semblant du CHAT, par exemple- deviennent observables au cours de la deuxième année.
Le protocole de la Recherche PREAUT
- Les signes PREAUT
- M. C. Laznik propose son hypothèse des signes PREAUT: Il y aurait, chez le bébé à risque d’évolution autistique, un ratage du troisième temps du circuit pulsionnel, c’est-à-dire une non-apparition de la capacité à initialiser les échanges sur un mode ludique et jubilatoire.
De nombreux travaux montrent que le bébé a, dès la naissance, un intérêt pour des éléments spécifiques de la voix de la mère (pulsion invocante). C’est le phénomène du mamanais. Au cours de la première année de la vie, le bébé montre aussi un vif intérêt à regarder et être regardé (pulsion scopique), et pour les jeux à manger et être mangé pour rire (pulsion orale). L’ensemble de ces échanges sont facilement observables pour le pédiatre.
- Dans sa description du circuit pulsionnel, Freud avait postulé qu’il y avait trois temps :
- 1° temps: Actif, le bébé va vers l’objet de satisfaction;
- 2° temps : Auto-érotique, le bébé prend une partie de son corps comme objet de satisfaction;
- 3°temps : dit de passivation pulsionnelle, le bébé se fait l’objet de satisfaction pulsionnelle de son autre familier (sa mère ou son substitut)
Voici comment se présentent, à l’observation, les trois temps dans le circuit pulsionnel oral:
- Dans le premier temps, actif, le bébé va vers l’objet, sur le plan oral: le sein ou le biberon
Dans le deuxième temps, auto-érotique, le bébé prend une partie de son corps comme objet, sur le plan oral : les doigts ou la tétine
Ces deux temps, bien connus, sont déjà observés par les médecins, qui leur attribuent, à juste titre, une grande importance dans le développement de l’enfant.
Mais le troisième temps du circuit pulsionnel oral est moins connu et risque de ce fait de ne pas être aussi souvent observé ; il se présente comme suit :
- Le bébé offre une partie de son corps pour que sa mère « goûte » si c’est bon
- La mère joue à faire semblant de goûter: « On en mangerait du bébé comme ça! »
- Le bébé montre sa joie d’avoir suscité la jouissance qu’il lit sur le visage (pulsion scopique) et dans la voix (pulsion invocante) de sa mère.
De nombreux films familiaux montrent ce type d’échanges spontanés entre les mères et les bébés bien portants au cours des repas, du change ou du bain.
Les scènes suivantes sont extraites des vidéos familiales utlisées par PREAUT dans la formation des médecins, et qui montrent comment un bébé bien portant, Fabien, cherche à provoquer la réaction jubilatoire de sa mère, alors que Marco, un bébé devenu autiste, ne le fait pas.
Fabien, 5 mois, est avec sa mère :
Elle joue à « le manger ».
Il lui tend ses doigts et son pied pour qu’elle « goûte si c’est bon ».


La mère joue à goûter, et dit, joyeusement: « On en mangerait du bébé comme ça ! ».
Alors Fabien relance l’interaction, lui offrant à nouveau ses pieds « à goûter », pour qu’elle recommence :

Finalement Fabien montre sa joie d’avoir causé le plaisir qu’il lit dans le visage de sa mère (pulsion scopique), et dans sa voix (pulsion invocante) :
Le deuxième temps n’est auto-érotique que s’il existe le troisième. En effet, il faut ce temps de plaisir partagé pour que le recours au corps propre - sucer ses doigts ou la tétine -, deuxième temps du circuit pulsionnel, devienne réellement “auto-érotique”.
Les bébés en risque d’autisme peuvent avoir des mouvements de succion qui sont des procédures auto-calmantes, sans pour autant être auto-érotiques. Ce qu’il semble manquer dans leur cas, c’est l’inscription de cette jubilation partagée dans l’échange avec son autre familier (habituellement, ses parents), et ce, quelle que soit la raison de cette défaillance (déficit d’équipement du bébé, déficit environnemental).
Les films familiaux nous apprennent aussi que même les bébés en risque d’autisme peuvent répondre parfois en regardant et souriant en situation de «protoconversation», mais qu’ils ne cherchent jamais à susciter l’échange dans le quotidien.
Dans les scènes qui suivent de la vidéo familiale PREAUT, Marco ne cherche pas à susciter l’échange dans les situations quotidiennes, même s’il est capable de répondre en situation de « proto-conversation » telle que décrite par C. Trevarthen.
Marco, à 2 mois et demi, répond en souriant et regardant ses parents en situation de « proto-conversation » :
Par contre, il ne regarde pas ni cherche à se faire regarder pendant les scènes quotidiennes de change ou du bain :
Par conséquent, dans la recherche PREAUT, nous considérons que le clignotant de risque s’allume quand le bébé ne cherche pas à susciter le regard pour le plaisir, ni par sa mère ni par le médecin, alors qu’il n’est pas spécifiquement sollicité pendant la consultation pédiatrique de routine de 4 et 9 mois. Les bébés bien portants montrent bien avant 4 mois ce plaisir à susciter le regard de leurs proches.
En conséquence, les signes PREAUT résultent de la combinaison de ces deux comportements, habituellement présents très tôt chez les bébés bien portants :
1) le bébé ne cherche pas à se faire regarder par sa mère (ou son substitut), en absence de toute sollicitation de celle-ci,
2) le bébé ne cherche pas à susciter l’échange jubilatoire avec sa mère (ou son substitut), en absence de toute sollicitation de celle-ci
Il y a une cohérence entre les signes PREAUT et les items du CHAT qui ont été identifiés comme prédicteurs de risque autistique – et en particulier avec le jeu de faire semblant.
Considérons le signe PREAUT qui consiste en l’absence de plaisir de la part du bébé à être mangé pour rire. Dans cet exemple, ceci signifie que le bébé ne se sent pas comme un “bon objet” satisfaisant pour sa mère, ce qui fait qu’il ne vérifie pas le plaisir qu’il peut déclencher en elle. C’est l’absence de la passivation pulsionnelle.
Dans le jeu de faire semblant testé par le CHAT, l’enfant est censé verser quelque chose de bon à boire et faire semblant de le boire ou le manger. Les enfants bien portants le font très facilement, et ajoutent fréquemment quelque chose de plus : il donnent quelque chose de bon à boire ou à manger à leur mère –ou à l’adulte qui joue avec eux. Nous pouvons considérer que l’enfant procède ainsi car il sent qu’il a quelque chose de bon à offrir à l’autre, et ainsi vérifie à quel point il est satisfaisant pour lui. C’est la passivation pulsionnelle.
En conséquence, nous pouvons considérer que la recherche PREAUT cherche à évaluer « un ensemble cohérent d’outils de repérage des troubles précoces de la communication pouvant présager un trouble grave du développement de type autistique ».
Le QDC (Questionnaire du développement de la communication) et le CHAT (Checklist for Autism in Toddlers)
Une autre série d’indices étudiés est issue d’une étude multicentrique coordonnée par le Pr. C. Bursztejn du CHRU de Strasbourg (Bursztejn et coll., à paraître). Dans cette recherche, 27 items signalés dans la littérature comme étant susceptibles d’annoncer l’apparition d’un trouble autistique ont été testés chez 2 350 enfants au cours d’examens de santé systématiques entre 8 et 13 mois. Au terme de cette étude 8 de ces items, dont la présence a pu être attestée chez au moins 95% des bébés sains examinés, ont été jugés suffisamment fiables pour être utilisés à cet âge.
La valeur de ces indices pour le dépistage des troubles du développement sera testée dans le cadre de l’étude PREAUT. Pour ce faire, ce « Questionnaire sur le Développement de la Communication » (QDC) sera administré à l’ensemble de la population incluse à l’age de 12 mois, que les signes PREAUT aient été observés ou non.
Par ailleurs, en 1995, l’équipe de S. Baron-Cohen a validé le CHAT (Checklist for Autism in Toddlers). Le CHAT est un questionnaire dont la passation demande de 5 à 10 minutes, comportant 9 questions posées aux parents et 5 items d’observation étudiant trois comportements qui font habituellement défaut chez les enfants autistes : l’attention conjointe, le pointage protodéclaratif et le jeu de faire semblant.
Dans une enquête portant sur une population de 16.000 enfants, les 10 cas suspects d’autisme détectés ont été confirmés à 42 mois. Mais si la spécificité du CHAT semble, ainsi, bien établie, une autre étude de la même équipe (Baird et coll., 2000) indique que sa sensibilité est relativement faible. Malgré cette limite, le CHAT apparaît donc être un outil qu’il serait utile d’expérimenter dans les conditions des examens de santé systématiquement réalisés dans notre pays. Il serait cependant intéressant de tenter d’améliorer sa sensibilité par un petit nombre items complémentaires.
La recherche PREAUT inclut ces deux épreuves qui seront proposées à l’ensemble de la cohorte à la suite des signes PREAUT, et ainsi, le protocole complet testera l’ensemble de ces outils, comme suit :
Les signes PREAUT (M.C.Laznik and coll.), à 4 et 9 mois ;
- Les signes PREAUT (M.C.Laznik and coll.), à 4 et 9 mois ;
- Le QDC (C. Bursztejn and coll.), à 12 mois ; et
- Le CHAT, dans la version française modifiée (C. Bursztejn and coll.), à 24 mois.
Déroulement de la recherche
La recherche Préaut est mise en place dans les départements où le travail du lien pédiatre-psychiatre existe déjà , ou bien où il y a un désir de le créer.
A présent, le partenariat a été conclu avec 10 départements de France métropolitaine et d’outre mer, et deux autres départements devant rejoindre la recherche en 2008/09. La formation s’adresse aux médecins de premier rang, recevant en consultation des bébés dès la naissance, dans le cadre du suivi pédiatrique habituel en PMI.
Programme de formation des médecins
1ère journée :
- Emergence des processus psychiques chez le bébé;
- signes de souffrance précoce
2ème journée : Présentation et étude des outils de la recherche:
- Grille PREAUT (M.C.Laznik et coll.),
- QDC (C.Bursztejn et coll.
- CHAT (version française élaborée par C.Bursztejn et coll.)
3ème journée :
- Mise en place de réseaux de partenariat PMI/structures locales du secteur pédo-psychiatrique, pouvant assurer la prise en charge des bébés dépistés;
- Présentation du dossier de lancement de la recherche PREAUT et discussion de la logistique.
Logistique de la recherche
Les médecins reçoivent un cahier par enfant, composé de quatre fiches à renvoyer pour saisie:
- La grille PREAUT à remplir lors de l’examen du 4° mois
- La même grille à remplir lors de l’examen du 9° mois
- Le QDC (Questionnaire sur le développement de la communication) à remplir lors de l’examen du 12è mois
- Le CHAT à remplir lors l’examen du 24è mois
L’Equipe Régionale de Référence
PREAUT a constitué une équipe de professionnels des Secteurs de psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent dans les départements partenaires de la recherche, volontaires pour recevoir les bébés dépistés par les médecins par rapport aux critères de risque de la recherche.
Validation des résultats
On proposera à la famille des enfant dépistés positifs aux signes de risque de la recherche de procéder, à partir de 24 mois, à une vérification diagnostique au moyen des outils diagnostiques reconnus internationalement (CARS, ADI, ADOS), auprès du Centre de Ressources Autisme le plus proche de son domicile. Pour les enfants non reconnus positifs, mais ayant présenté des signes de risque à l’un des examens de la recherche, il sera proposé, à l’issue du protocole, une évaluation clinique et développementale à l’aide d’instruments standardisés (Brunet-Lézine-R, WIPPSI et CARS), afin de connaître le devenir de ce groupe.
Phase de faisabilité de la recherche
Elle s’est déroulée de janvier 2002 à novembre 2004 dans 47 Centres de PMI de trois départements pilotes : les Hauts de Seine (92), l’Aude (11) et le Gard (30). Elle a porté sur un échantillon de 1.800 bébés
Sur les 1.800 réponses, aucune n’était à risque d’autisme confirmé aux deux passations du 4ème et du 9ème mois. Un seul bébé recensé positif à 4 mois s’est négativé à 5 et son examen était normal à 9 mois.
Environ 8% de bébés présentaient des troubles de la relation non-spécifiques de la recherche, ce qui recoupe l’incidence statistique des troubles relationnels précoces actuellement admise.
La phase opérationnelle
Le lancement est séquentiel : 9 départements ont commencé depuis 2006. A savoir : l’Aude, les Bouches du Rhône, la Côte d’Or, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, le Gard, le Loiret, la Guadeloupe et les Pyrénées Orientales. Le Val d’Oise a rejoint la recherche en 2008.
165 Centres de PMI de ces départements participent à la recherche, et la base de données inclut 11.318 enfants en août 2010.
L’ensemble de l’étude requiert un échantillon de 15.000 bébés, ce qui signifie un minimum de 3 ans d’inclusion de l’ensemble des départements partenaires. Certaines équipes participantes (Essonne, Bouches du Rhône, Côte d’Or, Hauts de Seine entre autres), ont accepté de prolonger la durée des inclusions, celles-ci se trouvant actuellement en deça des estimations initiales.
Par ailleurs, le déroulement de l’étude fournit aux médecins-chercheurs un support pour la prise en charge des troubles de la relation tout-venant, sous la forme de :
- une meilleure sensibilisation des médecins aux troubles relationnels précoces tout-venant,
- une mise en partenariat avec les équipes soignantes de proximité;
- une participation au Séminaire sur la Clinique du Bébé, qui se tient mensuellementdepuis 2003 à Paris, où les équipes de terrain sont invitées à venir présenter et discuter des situations d’enfants les préoccupant;
- depuis 2005, trois autres Séminaires ont vu le jour dans des Départements partenaires: à Dijon (Côte d’Or), Orléans (Loiret) et Pointe-à-Pitre (Guadeloupe);
- en 2007, trois autres suivent : à Carcassonne (Aude), à Marseille (Bouches du Rhône) et à Alès (Gard).
- une participation à la publication des situations cliniques présentées et discutées dans le Séminaire dans le cadre des « Cahiers de PREAUT »
-
Ces études constitueront, au fil du temps, un témoignage du travail accompli par les équipes de prévention
- Sept « Cahiers de PREAUT » sont actuellementdisponibles :
- « Aspects cliniques et pratiques de la prévention de l’autisme », 2004
- « Psychanalyse et neurosciences face à la clinique de l’autisme et du bébé », 2005
- « Autismes: Etat de lieux du soin », 2006
- « Actualités du soin : approches cognitivocomportementales et analytiques des troubles autistiques », 2007
- « Evaluations diagnostiques, évaluation des traitements de l’autisme », 2008
- « Evaluation des traitements des Troubles Envahissants du Développement », 2009
- « Approches cliniques et pédagogiques des TSA (Troubles du spectre autistique) », 2010.
Depuis 2005, PREAUT développe des programmes associés à l’étranger:
L’ Angleterre, l’Argentine et le Brésil mettent actuellement en place la sensibilisation des pédiatres et médecins de la petite enfance avec les programmes PREAUT.
En Angleterre :
The School of Infant Mental Health à Londres, pilotée par S. Acquarone,
- A démarré en novembre 2006 des formations adressées aux pédiatres et professionnels de la petite enfance, en association avec PREAUT et dans le cadre de l’IPAN (International Pre-Autistic Network), réunissant des professionnels d’Angleterre, France, Italie, Israël et Etats Unis.
En Argentine :
Le programme « Mirar y Prevenir », piloté par N. Scheimberg,
- met en place depuis juillet 2005 un partenariat avec les médecins de santé publique de Buenos Aires en Argentine. Diverses actions de santé publique associées aux programmes de formation de pédiatres PREAUT ont été mises en place à Buenos Aires.
Au Brésil :
L’Instituto da Familia de Sao Paulo au Brésil, piloté par le Dr. L. Posternak, dans son programme « Nouvelles pratiques en pédiatrie »,
- Une application du protocole de la recherche PREAUT a été lancée dans 8 états brésiliens à partir d’octobre 2010, en partenariat avec l’Instituto da Familia, l’Instituto du langage de São Paulo et l’Association « Viva Infancia » de Salvador de Bahia.
- Depuis 2005, un séminaire annuel forme des pédiatres boursiers de l’état de Sao Paulo. Des pédiatres de l’état de Matto Grosso ont pu être inclus dans le programme moyennant des modules de formation à distance « en ligne ».
- La première version portugaise des « cahiers de PREAUT » est parue en août 2007 ; d’autres numéros, comportant des articles de professionnels brésiliens doivent suivre, en collaboration avec l’Instituto du Langage de São Paulo.
Depuis 2007, l’équipe PREAUT met à disposition des équipes soignantes des cycles de formation :
- A la prévention des troubles relationnels précoces, aux thérapies parents/bébés
- Aux apports des neurosciences dans les pratiques institutionnelles
- A la prise en charge institutionnelle des enfants autistes, dans une approche à la fois éducative et subjectivante
- A une approche de pédagogie structurée pour enfants avec TSA
- Aux techniques d’évaluation et à la mise en place de projets éducatifs individuels
Vous pouvez consulter le contenu détaillé de ces programmes dans notre site preaut.fr, rubrique Formations.
En janvier 2010, l’équipe PREAUT a créée l’Unité d’Accompagnement PREAUT (UDAP)
qui est une plateforme offrant aux familles d’enfants avec autisme :
- Un suivi pluridisciplinaire,
- Une vérification diagnostique si nécessaire
- un accompagnement de la scolarité et
- une guidance à domicile, selon un protocole personnalisé et régulièrement évalué afin de l’adapter sans cesse à l’évolution de chaque enfant.
L’Unité accueille fin 2010 une vingtaine de familles, et sa capacité d’accueil est estimée à une cinquantaine de familles. Vous avez accès à l’organisation détaillée de notre Unité sur preaut.fr, rubrique « Unité d’Accompagnement PREAUT ».
Résultats espérés et perspectives
En dehors de l’intérêt de la validation de l’ensemble d’outils, nous sommes confiants que le dépouillement des données de la base constituée par le déroulement de notre étude contribuera durablement à développer les connaissances non seulement sur les troubles graves du développement mais aussi sur les troubles relationnels précoces en général.
Par ailleurs, l’ensemble d’initiatives développées autour de PREAUT :
- Séminaires d’enseignement
- Formation de professionnels
- Publications
- Dispositif d’accompagnement à domicile
- Classes expérimentales pour enfants avec TSA
devraient continuer à se consolider, constituant en elles-mêmes et indépendamment de la recherche, des apports dans le champ du dépistage, du traitement et de l’accompagnement d’enfants avec TSA et leurs familles.